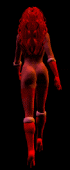Enfin une info claire
Chef d’entreprise, vous venez de recevoir un avis de contravention pour excès de vitesse commis par l’un de vos chauffeurs ou de vos collaborateurs , comment contester ?
Nombre d’employeurs, dans l’ignorance des règles de droit, continuent de dénoncer leurs chauffeurs ou collaborateurs lorsque ceux-ci ont commis des infractions au code de la route (excès de vitesse ou autre) sans avoir été interpellés : «Mon employeur s’est renseigné et on lui a répondu qu'en cas de non dénonciation c'est lui,le chef d'entreprise, qui aurait les points enlevés de son permis ».
C’est faux ! Mais, il convient si l'on souhaite contester de respecter la procédure sous peine de se voir déclarer coupable d’une infraction que l’on a pas commise !
Les délais de contestation :
Tout d’abord, à réception de l’avis de contravention adressé au titulaire de la carte grise (c’est à dire au représentant de la société), le délai de contestation est de 45 jours. A défaut de contestation, c’est une amende forfaitaire majorée qui sera adressée au chef d’entreprise. L’envoi de l’amende forfaitaire majorée ouvre un nouveau délai de contestation de 30 jours (art. 530 du code de procédure pénale) Il y a donc deux délais de contestation : on peut donc contester 2 fois !
Les motifs de la contestation :
Que la contestation soit faite dans les 45 jours de l’amende forfaitaire, ou qu’elle intervienne dans les 30 jours de l’amende forfaitaire majorée, il est indispensable d’indiquer les raisons de la contestation. Sinon, la réclamation sera rejetée. Le chef d’entreprise indiquera donc qu’il conteste avoir commis personnellement l’infraction s’agissant du véhicule de la société. Il précisera (éventuellement) qu’il ne connaît pas le chauffeur compte tenu du nombre de personnes susceptibles de conduire le véhicule de société. La délation n’est en effet nullement obligatoire : aucun texte n’exige de l’employeur qu’il donne le nom du chauffeur.
La forme de la contestation :
Vous pouvez être dans votre bon droit mais si vous ne respectez pas la procédure pour contester, votre requête sera rejetée. Vous devez donc impérativement pour contester (art. 529-10 du code de procédure pénale) :
- Si vous entendez donner le nom du chauffeur (dénonciation nullement obligatoire) Adresser le formulaire signé de la requête en exonération (en renseignant le cas n°2). Vous y préciserez l’identité, l’adresse et la référence du permis de conduire de la personne présumée conduire au moment de l’infraction; Un nouvel avis de contravention sera alors établi et adressé au conducteur désigné
- Si vous n’entendez pas donner le nom du chauffeur ou ne le connaissez pas, vous devez :
- Utiliser le formulaire de requête en exonération (ou rédiger une lettre) expliquant que vous ne savez pas qui conduisait ;
- justifier du montant de la consignation préalable (c’est obligatoire). Cette consignation égale au montant de l’amende forfaitaire, soit 135 euros ou à celui de l’amende forfaitaire majorée, soit 375 euros. La consignation n’est pas une amende : aucun point ne sera retiré.
La consignation pourra être payée :
- par téléphone au 0.820.11.10.10 , avec une carte bancaire,
- par Internet sur le site www.amendes.gouv.fr, avec une carte bancaire,
- par chèque à l'ordre du trésor public,
- par timbre amende. - Joindre l’avis de contravention si la réclamation intervient après l’envoi de l’avis d’amende forfaitaire majorée ;
- Signer le formulaire ou la lettre et adresser le tout par courrier recommandé avec accusé de réception.
L’officier du Ministère Public, au vu de la requête recevable (si vous avez omis de respecter la procédure, c’est irrecevable), pourra alors :
· classer sans suite et vous pourrez demander le remboursement de la consignation;
· ou engager des poursuites devant le Tribunal de Police. Dans ce dernier cas, une audience sera fixée. A l’audience, la photographie du conducteur sera, en principe, au dossier du Tribunal et le chef d’entreprise fera ainsi la preuve de sa non culpabilité. Il devrait alors être relaxé et ce dernier ne pourra pas faire l’objet d’une condamnation pénale (pas de suspension de permis, pas de retrait de points). En revanche, il y a de fortes chances que le Tribunal le déclare « redevable pécuniairement » bien que la photo ne lui corresponde pas ! Cette distinction entre « condamné pénalement » et « redevable pécuniairement » a été instauré pour inciter à dénoncer le véritable conducteur.
En conclusion, en cas d’excès de vitesse par l’un de ses chauffeurs, le chef d’entreprise doit obligatoirement respecter la procédure de contestation s’il n’entend pas se voir retirer des points personnellement. Le paiement de l’amende sans contestation vaut en effet reconnaissance de cupabilité.
Il n’a aucune obligation de délation car aucun texte ne le prévoit. Il n’y a donc aucune sanction à ne pas dénoncer. Le seul risque est de se voir, en qualité de représentant de la personne morale, tenu de payer « la redevance pécuniaire » après contestation.
Maître Farajallah, Avocat au Barreau de Paris, Spécialiste en droit pénal et enseignant à l’Ecole de Formation du Barreau de Pari