| Le grand drame de la Birmanie contemporaine s'est déroulé dans la matinée du 19 juillet 1947 quand une dizaine d'hommes en uniforme ont fait irruption dans le bâtiment du Secrétariat, au centre de Rangoon, et ont mitraillé Aung San, le jeune leader indépendantiste, et les membres de son cabinet. L'assassinat, organisé par un rival politique, priva la Birmanie, avant même son indépendance, du seul homme qui possédait l'intelligence politique, le charisme et la force de caractère pour guider le pays émancipé à travers les périls de l'édification nationale. Composée à plus de 30% de minorités ethniques, la Birmanie a une tendance naturellement centrifuge.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Birmans, alliés aux Japonais, avaient massacré des Karen qui étaient restés fidèles à l'armée britannique. A la fin du conflit, au sortir de ses luttes fratricides, Aung San était le seul politicien birman respecté par les leaders des minorités ethniques. A Panglong, en février 1947, il avait réussi à conclure un accord avec les minorités shan, kachin et chin pour les intégrer dans l'Union de Birmanie sous l'égide d'une Constitution fédérale. Agé de seulement 32 ans, l'homme providentiel de Birmanie disparaissait - un meurtre dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui.
Le premier chef de gouvernement birman fut un de ses compagnons de lutte: U Nu, un intellectuel versé dans le bouddhisme et qui avait été un des leaders du mouvement étudiant anti-colonial. Presque immédiatement, la tendance à la division - un trait culturel birman, selon un bon connaisseur du pays - prit le dessus. Les Karens prirent le maquis, suivis par plusieurs factions communistes du mouvement nationaliste birman. Les Shans et les Kachins leur emboîtèrent le pas.
La Birmanie n'en connut pas moins une vie démocratique vivace, quoique chaotique, entre 1948 et 1962. Les Birmans de Rangoon, cosmopolites et cultivés, étaient fiers à juste titre de leur système éducatif: l'Université de Rangoon était l'une des plus réputées de la région. Le programme de social-démocratie à la scandinave initié par U Nu n'évita pas certains faux pas, comme le renvoi de tous les techniciens qui avaient servi l'administration coloniale. Mais il permit de développer l'agriculture dans la plaine centrale, le berceau culturel du pays. Une agriculture qui devint l'une des plus productives de la région. Le pays profitait aussi de ses riches ressources naturelles, hydrocarbures et pierres précieuses.
Fragilisé politiquement et peu désireux de faire face à un parlement hostile, U Nu commit l'erreur de confier en octobre 1958 la direction du gouvernement au chef des forces armées, le général Ne Win, un camarade d'armes d'Aung San, à la réputation de joueur et de coureur de jupons. L'armée géra donc le pays pendant deux ans et y prit goût. Elle développa une doctrine proche de la dwifungsi indonésienne, s'attribuant une double mission: défendre le pays et prendre en charge son développement économique et social. Aussi en mars 1962, alors qu'U Nu était sur le point de conclure un accord politique avec plusieurs minorités ethniques, Ne Win et ses lieutenants s'emparèrent du pouvoir, établissant un Conseil révolutionnaire de 24 membres qui investit le nouvel homme fort du pays des pleins pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.
Avec l'aide d'idéologues marxistes, Ne Win formula une nouvelle philosophie politico-économique, «la Voie birmane vers le socialisme», un mélange de marxisme, de pensée bouddhiste et d'humanisme, qui traduisait une tentative par le régime militaire de relier, tant que faire se peut, cette doctrine aux traditions politiques birmanes. Les partis politiques furent dissous et remplacés par une formation unique, le Parti du programme socialiste birman (PSBB), dirigée par le Conseil révolutionnaire. Toutes les entreprises furent nationalisées. Une démonétisation poussa quelque 200000 commerçants et entrepreneurs, originaires d'Asie du Sud mais établis en Birmanie depuis plusieurs générations, à regagner l'Inde ou le Pakistan. Des «magasins du peuple», censés constituer l'unique réseau de distribution pour satisfaire les besoins de la population, apparurent. Mais l'absence de compétition privée et la rigidité idéologique aboutirent à un effondrement du système économique, comme l'a décrit Bertil Lintner, un journaliste spécialisé sur la Birmanie (1): «La distribution était si mal organisée que les quelques produits de consommation fabriqués dans le pays atteignaient les régions périphériques plusieurs mois après avoir quitté les usines. Les parapluies arrivaient au début de la saison chaude et les couvertures quand les pluies commençaient.»
Dans les années 1980, la mauvaise gestion, l'isolement presque total du pays et l'idiosyncrasie du leader Ne Win firent toucher le fond à l'économie birmane. La Birmanie demanda et obtint le statut de Pays le moins avancé (PMA) auprès des Nations unies, afin de bénéficier d'un soutien financier pour faire face à sa dette extérieure (3,5 milliards de dollars) écrasante. Cela fut ressenti comme une humiliation par les Birmans, bien conscients des richesses naturelles de leur pays. Les réquisitions croissantes de riz - acheté par le gouvernement à des prix inférieurs à ceux du marché - attisèrent le mécontentement des campagnes. Dans un village au nord de Rangoon, quatre émissaires du gouvernement furent lynchés; dans le village de Kyauktan, au sud-est de la capitale, une rizerie appartenant à un officiel fut incendiée. Une nouvelle démonétisation annoncée brutalement le 1er septembre 1987 fut la goutte de trop. Les anciennes coupures furent remplacées, sans explication, par de nouveaux billets de 45 et de 90 kyats. Le chiffre neuf était le chiffre porte-bonheur de Ne Win. Les économies de millions de Birmans se volatilisèrent instantanément.
L'étincelle qui mit le feu aux poudres fut une simple bagarre, le 12 mars 1988, dans un tea shop de Rangoon entre trois étudiants et des jeunes, parmi lesquels le fils d'un officiel du gouvernement. Cet enfant de notable avait gravement blessé un étudiant, mais il fut relâché le lendemain par la police. Pendant sept jours, des manifestations massives d'étudiants eurent lieu à Rangoon. Les protestataires exigèrent d'abord une enquête officielle sur l'incident du tea shop. Puis ils adoptèrent un ton plus politique. Leur cri de ralliement devint: «A bas la dictature fasciste!» L'armée, placée sous la direction de Swein Lwin, un fidèle de Ne Win, répondit par une répression sans merci. Le 15 mars, plusieurs milliers d'étudiants défilèrent sur la rue Prome, agitant le drapeau frappé d'un paon combattant, symbole du nationalisme birman. Le cortège fut fauché à la mitrailleuse. Cette bouffée de colère contre le régime prit fin le 18 mars, après l'arrestation de plusieurs milliers d'étudiants.
Le mouvement de protestation, mieux organisé, refit surface en juin et de nouveaux massacres eurent lieu. Le dictateur Ne Win annonça sa démission de la direction du Parti unique le 25 juillet, mais il fut remplacé par son bras droit, Sein Lwin, abhorré par les Bimans qui le surnommaient «le boucher de Rangoon». Pendant deux mois, Rangoon fut le théâtre de manifestations et de grèves durement réprimées, comme lors du massacre du 8 août 1988 devant la mairie de Rangoon. Le 18 septembre 1988, l'armée réaffirma son contrôle par un effroyable massacre lors duquel un millier de manifestants, pour l'essentiel des écoliers, furent tués par balles ou à la baïonnette. «Ce qui s'est passé est tellement honteux que je n'ai pas de mots pour le qualifier», s'émut un ambassadeur occidental en poste à Rangoon.
Entre-temps, une nouvelle figure était devenue le point de ralliement du mouvement démocratique: Aung San Suu Kyi, la fille du héros national Aung San. Elle avait quitté sa maison d'Oxford en 1988 pour venir au chevet de sa mère malade, à Rangoon. Le 25 août 1988, elle avait séduit près d'un demi-million de Birmans venus l'écouter lors de son premier discours public près de la pagode Shwe Dagon. Son ton direct, son charme, son intelligence leur rappelaient le jeune nationaliste assassiné quarante ans plus tôt. La junte militaire comprit vite le danger que représentait cette femme déterminée et tenace. En juillet 1989, les généraux l'assignèrent à résidence dans sa demeure de Rangoon. A leur surprise, le parti qu'elle avait fondé, la Ligue nationale pour la démocratie (LND), remporta plus de 80% des voix lors des élections législatives de mai 1990. Prise au piège de leur promesse de «démocratie multipartite», la junte n'eut d'autre recours que d'ignorer les résultats des élections. Isolés de la communauté internationale par les sanctions et de plus en plus coupés de la population birmane, les militaires s'attachèrent à saper par tous les moyens l'influence de la LND. Entre 1989 et aujourd'hui, Aung San Suu Kyi a passé douze années assignée à résidence.
Les défilés de bonzes et de laïcs du mois dernier semblent constituer une répétition du scénario de 1988. Un ressentiment fondé sur la détérioration de l'économie - les augmentations de 100 à 500% des prix du carburant en août - se transforme en revendication politique pour un changement de régime. Sauf que la répression brutale encore possible il y a dix-neuf ans est devenue plus problématique aujourd'hui: la junte a été prise de court par la vigueur de la réaction internationale après les premiers coups de feu contre les moines. L'opposition pro-démocratique avec ses multiples réseaux clandestins est mieux organisée. Il reste à voir si le régime militaire a la capacité de se plier à un transfert progressif du pouvoir ou s'il va résister obstinément jusqu'à son effondrement.
(1) Outrage. Burma's Struggle for Democracy, par Bertil Lintner (White Lotus, Bangkok, 1990).
|
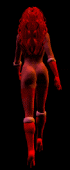


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire